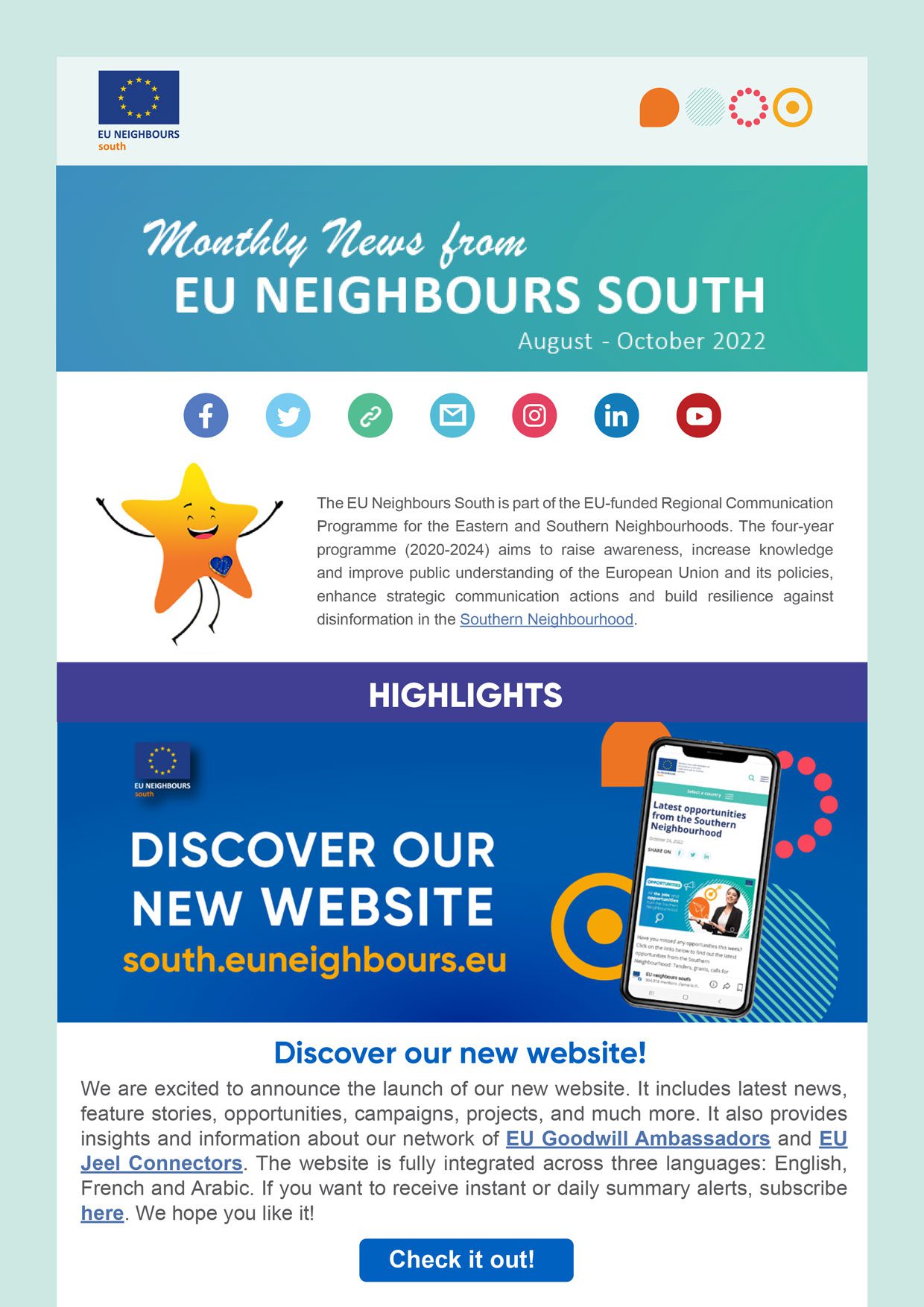La relation entre l’UE et le voisinage sud en transition: Des frontières «fermées» aux frontières semi-ouvertes en Méditerranée?

La guerre en Ukraine a mis au premier plan la question des frontières, à la fois en tant que priorité mais aussi en termes de déplacement dans le voisinage de l’UE. Plutôt que de se rapprocher d’un monde «sans frontières», tel qu’annoncé par l’avènement de la mondialisation, les États cherchent de plus en plus à renforcer leur contrôle sur des entités territoriales spécifiques délimitées par des frontières et des frontières. Cela se reflète également dans le projet européen. La vision d’une UE sans frontières, à travers l’espace Schengen de libre circulation, a été fondée dès le début sur l’hypothèse que la mobilité interne repose fortement sur le renforcement externe de ses frontières. La libre circulation ne s’applique qu’aux citoyens des États membres et aux ressortissants de pays tiers résidant légalement à l’intérieur des frontières européennes. Inévitablement, cela a créé une distinction entre les frontières intérieures, dont l’importance a diminué, et les frontières extérieures, qui sont à l’avant-garde du débat politique sur la migration.








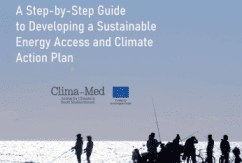
























 Syrie
Syrie