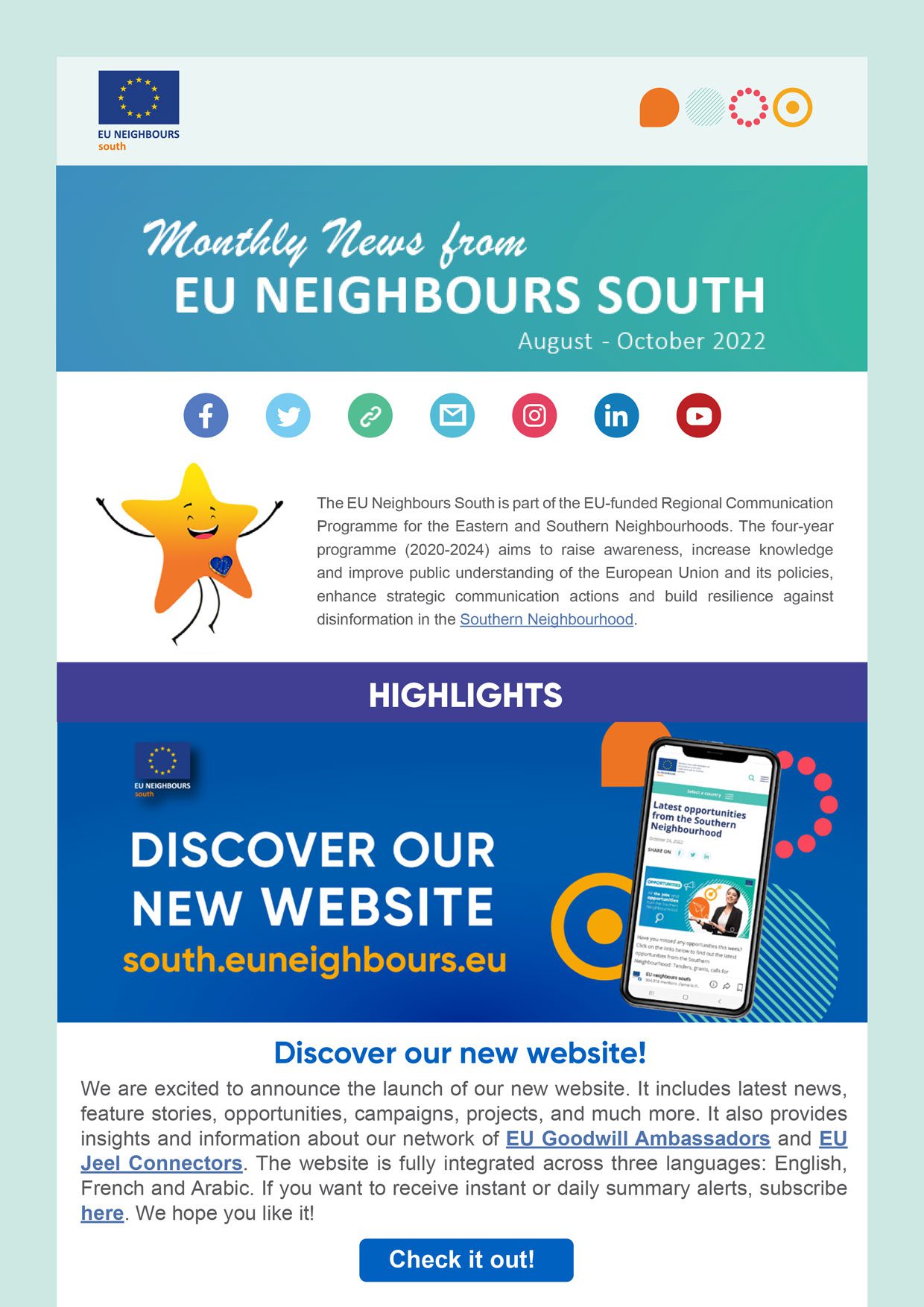La Renaissance du Chemin de Darb al-Ahmar | Un voyage dans le Ramadan du Caire entre le passé et le présent
Le cortège commence au château, mené par des hommes portant des torches et des bâtons, effectuant des mouvements rythmiques. Parmi eux, des musiciens ajoutent au spectacle, certains à dos de chameaux, d’autres sur des ânes, battant des tambours ou jouant des instruments à vent. Ensemble, ils traversent les ruelles du Caire, annonçant aux habitants l’arrivée du croissant de lune et la première nuit du Ramadan. Quelques siècles plus tard, au même endroit connu sous le nom de Bab al-Wazir, une voix forte résonne depuis la télévision : « Demain est le premier jour du Ramadan. » Muhammad Ali décore son restaurant, servant du foul et de la taamia, et installe des tables devant la mosquée et l’école d’Um Sultan Shaaban, où passe le cortège ce jour-là. Il se prépare pour son premier Suhoor et le début de sa saison la plus intense et la plus chérie.
Contrairement aux autres restaurants du quartier, le sien se distingue. Niché le long du chemin touristique de Darb al-Ahmar, il se trouve à la croisée des monuments historiques et des marchés artisanaux traditionnels. Le projet Darb al-Ahmar, une initiative de la Fondation Aga Khan et du Ministère du Tourisme et des Antiquités, financée par l’Union européenne, a pour objectif de restaurer ses mosquées et de revitaliser ses boutiques. Sur environ deux kilomètres, le parcours attire les visiteurs vers d’autres époques, mettant en lumière, à chaque coin de rue, les rituels du Ramadan tels qu’ils étaient pratiqués il y a des siècles.


« Ô fidèles du meilleur des créatures de Dieu ! Jeûnez, jeûnez ! » Les équipes scandent ces paroles en parcourant chaque recoin du Caire pour annoncer l’arrivée du Ramadan. Dès que la nouvelle de l’observation du croissant atteint le juge, les mosquées s’illuminent et des lanternes sont suspendues à leurs entrées et au sommet de leurs minarets.
Les rues s’animent alors que les habitants se rassemblent, veillant tard dans la nuit et chantant dans les ruelles du mur fatimide du Caire. Ce mur, construit en trois phases, fut d’abord érigé en briques de terre crue par son fondateur, Jawhar al-Siqali, commandant des armées fatimides. Plus tard, Badr al-Din al-Jamali, vizir du calife fatimide al-Mustansir Billah, le renforça. Enfin, sous le règne de Salah al-Din al-Ayyubi, il fut prolongé de la citadelle à Fustat, englobant l’ensemble de la capitale.
Une grande partie du mur de Salah al-Din subsiste encore aujourd’hui. C’est d’ailleurs à partir de ce point que les « voitures de golf » électriques mises à disposition par le projet du chemin touristique transportent désormais les visiteurs vers les différents arrêts du parcours.

Le véhicule serpente les routes entrelacées. De l’intérieur, Leonardo observe les panneaux bruns fixés sur les murs crayeux, indiquant les arrêts qu’il doit effectuer dans le quartier de Darb al-Ahmar, axe nord-sud de la ville historique. Tout comme les cortèges de sultans et les festivités populaires qui jadis partaient de la citadelle vers les marchés et les palais, Leonardo et ses compagnons suivent le même itinéraire, soigneusement conçu pour refléter ces processions du passé.
Cet Italien de 55 ans déclare : « Ce n’est pas la première fois que je visite Darb al-Ahmar et le Caire historique, mais c’est la première fois que tout est organisé ainsi. J’ai pu entrer dans des endroits que je n’avais jamais vus auparavant. » Ce qui l’a attiré le plus vers le Caire en cette période, c’est le mois du Ramadan. Ses décorations ont capté son regard alors qu’il arpentait les rues, appareil photo en main. « Je pense que cette ambiance n’existe qu’en Égypte, surtout dans des endroits comme celui-ci », remarque-t-il. Son sentiment correspond parfaitement à la vision de la dernière campagne du Ministère du Tourisme et des Antiquités, « L’Égypte a une âme pendant le Ramadan ». Lancée pour une durée d’un mois et demi, cette initiative vise à attirer des milliers de visiteurs comme Leonardo, les invitant à découvrir et à célébrer l’esprit unique du Ramadan en Égypte.

À l’approche de l’Iftar, « Le Caire semble s’être réveillé de sa transe », comme le décrit Richard Burton, un voyageur irlandais qui l’a visité en 1853. « Les gens regardent alors par leurs moucharabiehs et leurs balcons pour guetter l’heure de leur salut qui approche. »
À cette heure précise, Muhammad Ali, surnommé Quitta (le Chat), se tient devant son restaurant, distribuant des dattes et des jus. Son établissement, connu pour servir du foul et de la taamia, est le premier de la rue – un héritage commencé par son grand-père en 1947. Ce n’est que l’année dernière que le magasin a connu un changement. C’est à ce moment-là que des représentants et des ingénieurs de la Fondation Aga Khan sont arrivés, expliquant l’importance de sa restauration et de son développement, compte tenu de son emplacement privilégié sur le parcours touristique. Son grand-père avait eu la chance de choisir cet emplacement ! Quitta n’a pas hésité un instant avant d’accepter les rénovations. « Nous voulons être comme la rue Al-Moez – des touristes et des visiteurs venant de partout, surtout pendant le Ramadan », dit-il en frappant sur la table et en faisant un geste autour de lui. « Il y a tellement de monuments importants ici, tout comme Al-Moez, peut-être même plus ! »
Il n’a pas rechigné à fermer son restaurant pendant près de deux mois, avant d’être stupéfait par sa transformation. La nouvelle façade, ornée de pierre hachémite, d’ombrelles en bois et de portes de style islamique, a remplacé l’ancienne structure en acier qui se fondait autrefois dans les boutiques environnantes. Pourtant, une chose est restée inchangée : les murs en céramique andalouse, qu’il avait conçus pour refléter ceux de la Mosquée Bleue voisine, la mosquée Aq Sunqur. Construite par l’un des Mamelouks d’Al-Nasir Muhammad bin Qalawun, cette mosquée possède une cour ouverte entourée de quatre arcades, trois grandes entrées et des murs ornés d’une somptueuse porcelaine bleue. « Je suis attaché à tout ici, et ma joie pour le restaurant ne vient pas seulement du fait que tous les touristes qui visitent la Maison du Vizir deviennent mes clients, mais aussi parce qu’il est désormais à la hauteur des lieux qui l’entourent », dit Quitta, qui est né et a toujours vécu dans le même quartier.

Alors que le soleil disparaissait derrière les dômes et les minarets, une forte détonation résonna autrefois à travers Le Caire, à une époque indéterminée, surprenant ceux qui priaient ou rompaient leur jeûne le premier jour du Ramadan. Se précipitant pour en découvrir la cause, beaucoup pensèrent qu’il s’agissait d’une nouvelle manière d’annoncer l’Iftar. En réalité, c’était un coup de canon tiré accidentellement. Pourtant, cet événement inattendu devint rapidement une tradition et, depuis, le canon marque la rupture du jeûne depuis la citadelle.
Aujourd’hui, lorsque le canon retentit virtuellement à la télévision ou à la radio, Abdulrahman Samir est le dernier à fermer son magasin dans la rue Bab al-Wazir, attendant le départ de ses derniers clients. En rentrant chez lui, les regards se tournent vers lui – « Quel homme chanceux ! » murmurent les passants, admirant son choix de rénover son épicerie. Certains l’arrêtent même pour lui demander : « D’autres magasins sur le parcours seront-ils restaurés ? »
À 37 ans, Abdulrahman n’a pas de réponse claire. Il ne sait même pas pourquoi son magasin a été sélectionné. « C’était une opportunité qui s’est présentée à moi », dit-il. Mais le général Ahmed Helmy, coordinateur général des projets de la Fondation Aga Khan, explique les critères de sélection : « Des facteurs comme l’emplacement, le statut juridique du magasin et de la propriété, l’adaptabilité à la restauration et la stabilité structurelle ont tous joué un rôle. »
Pendant cinquante jours, l’équipe du projet a travaillé sur l’épicerie d’Abdulrahman. Il ne s’en est jamais éloigné, observant leur progression jour après jour, même après avoir loué un espace voisin pour continuer à vendre ses produits. « Ils l’ont transformée de fond en comble », dit-il en balayant du regard la boutique, désignant le plafond en bois et le nouveau sol. Le projet a métamorphosé l’épicerie d’Abdulrahman, vieille de plus de soixante-dix ans et devenue un repère pour les visiteurs lors de leur onzième arrêt, près de Beit al-Razzaz, l’une des plus belles maisons mameloukes du XVe siècle, autrefois habitée par un marchand comme Abdulrahman, du nom d’Ahmed Katkhuda al-Razzaz.
Pour Razzaz et d’autres familles de la région, les journées de Ramadan étaient consacrées « aux prêches dans les mosquées, au travail ou surtout au sommeil », comme l’a noté Adam François Jomard, l’archéologue et cartographe français. Mais le soir, lorsque les rues s’animaient de lumières et de mouvements, « ils se réunissaient vêtus de leurs plus beaux habits, dégustaient des sucreries et s’adonnaient à toutes sortes de divertissements. »
Entre le jour et la nuit, leurs humeurs changeaient. Comme l’observait l’orientaliste anglais William Lane : « Ils sont maussades le matin mais exceptionnellement amicaux et affectueux le soir. Ceux de condition moyenne passent leurs soirées dans les cafés, organisant des rassemblements sociaux ou écoutant des conteurs populaires, tandis que des fenêtres des maisons résonnent des louanges à Allah tout au long du mois. »
Mohammed Al-Haddad, un artisan créateur d’objets et d’antiquités, ne diffère en rien de ses prédécesseurs de la région. Après les prières de Taraweeh, il se rend dans le café populaire du quartier avant de rentrer pour ouvrir sa boutique, remplie de statues et de décorations de Ramadan, qu’il a pour la plupart fabriquées dans son atelier.En marchant, Al-Haddad salue les commerçants assis devant leurs magasins – tout le monde le connaît. Au fil des ans, il a formé une trentaine d’entre eux à la fabrication d’objets et d’antiquités à travers des ateliers organisés dans le cadre du projet de développement du parcours. Certains ont ouvert leur propre boutique, tandis que d’autres ont élargi et perfectionné leurs produits. Réfléchissant à son rôle, Al-Haddad parle avec fierté. « Y a-t-il quelque chose de plus important que d’ouvrir la porte à une source de revenus ? » dit-il, la voix empreinte de satisfaction face à ce qu’il a contribué à bâtir.
La plupart des œuvres d’Al-Haddad s’inspirent de l’architecture islamique qui l’entoure, en particulier de la mosquée Al-Mardani, douzième arrêt du parcours. Ce monument a rouvert l’an dernier après une vaste restauration menée selon les méthodes du maître Ibn Al-Sioufi, ingénieur en chef du sultan Al-Nasir Muhammad, pour restituer son design original de 1340, conçu par le prince mamelouk Al-Tanbgha Al-Mardani. La restauration a préservé les éléments architecturaux distinctifs de la mosquée, notamment son revêtement en marbre, ses colonnes de granit et ses chapiteaux datant de l’époque romaine, soigneusement restaurés et réutilisés dans l’édifice.

La mosquée Al-Mardani se remplit à chaque prière, notamment lors des prières de Taraweeh et de Fajr, comme à l’époque du prince Al-Tanbgha Al-Mardani. Autrefois, les Masaharatis – ces crieurs traditionnels du Suhoor – parcouraient les rues chaque nuit, louant Allah devant les maisons des musulmans qui pouvaient se permettre de les récompenser. Comme le rapporte William Lane, « chaque Masaharati était accompagné d’un garçon portant deux lanternes dans un cadre de feuilles de palmier. »
Lane décrit également comment les femmes, cachées derrière leurs moucharabiehs, jetaient cinq pièces ou un piastre – parfois plus – enveloppés dans un morceau de papier enflammé pour que le Masaharati puisse voir où il était tombé. Après l’avoir ramassé, il récitait la sourate Al-Fatiha sur demande ou racontait une courte histoire, souvent rythmée et déséquilibrée, mettant en scène deux épouses en perpétuelle querelle.
Le Masaharati d’autrefois n’existe plus vraiment, et s’il y en a encore un, il ne connaît plus chaque maison ni le nom de tous les habitants. Pourtant, Shaima Ismail, qui vit sur le parcours, aime toujours lui rappeler, chaque fois qu’elle le croise, les noms de ses enfants. Ne dormant que quelques heures la nuit, elle se rend tôt à sa boutique, empilant sur les étagères extérieures en bois les antiquités qu’elle fabrique en forme de lanternes ou de croissants de lune.

Shaima a toujours aimé recycler et fabriquer des objets pour ses voisins, bien avant qu’une opportunité ne vienne changer sa vie. Grâce à un emploi et une formation avec la Fondation Aga Khan, elle a découvert sa passion pour l’artisanat, investissant peu à peu dans son propre équipement via des paiements échelonnés. Avec le soutien de la Fondation, elle a fini par louer cette boutique, un lieu qu’elle décrit comme « un rêve devenu réalité ». Le destin l’a encore favorisée lorsque son magasin, idéalement situé sur le parcours touristique, a été sélectionné pour être restauré. Elle se souvient comment, avant la rénovation, elle avait recouvert ses murs de linoléum usé – un contraste frappant avec l’espace magnifiquement peint où elle se tient aujourd’hui.
La lanterne suspendue devant la boutique et la maison de Shaima, comme au-dessus de toutes les habitations du parcours, ressemble à celles que les habitants accrochaient pour accueillir le calife fatimide Al-Mu’izz li-Din Allah lorsqu’il entra au Caire de nuit, le cinquième jour du Ramadan – l’un des récits les plus célèbres expliquant le lien entre la lanterne et ce mois sacré.
À l’arrêt final du parcours, la rue Khayamiya, les ruelles sont bondées de lanternes, de décorations et de clients impatients. Sous son toit en bois distinctif, Ahmed Juma se concentre sur la vente de lanternes en patchwork plutôt qu’en cuivre et en verre, autrefois plus courants à l’époque du calife.Ce n’a pas toujours été ainsi pour Juma. À 47 ans, après avoir passé près de la moitié de sa vie dans ce métier, il se souvient d’une époque différente. Après avoir suivi une formation dans le cadre du projet de la Fondation Aga Khan – soutenu par l’Union européenne – il a appris auprès d’experts italiens et français, maîtrisant la fabrication artisanale de produits de haute qualité et exposant même son travail à Paris. Mais avec le déclin du tourisme, ses ouvriers se sont tournés vers les tuk-tuks (taxis à trois roues), ne lui laissant d’autre choix que de se reconvertir dans la vente de décorations imprimées et préfabriquées. En parlant, Juma semble peu convaincu, presque mal à l’aise avec ses propres mots. « Le travail manuel est difficile et coûteux, il prend plus de temps et n’en vaut pas la peine », dit-il.
Contrairement à l’époque ottomane, où la rue Khayamiya était l’un des marchés les plus importants de la ville, réputé pour ses produits faits main, Juma suit désormais les exigences des commerçants et du marché. Autrefois, après sa fondation par le prince Radwan Bey Al-Faqari au XVIIe siècle, elle était connue sous le nom de Kasbah Radwan Bey, un véritable centre d’artisanat et de savoir-faire.

Le parcours s’achève à Bab Zuweila, où, du sommet de son minaret, on embrasse d’un regard toutes les étapes précédentes — plus de 700 ans d’histoire étalés sous nos yeux. Il révèle également les travaux en attente de financements et de futurs projets, comme la mosquée Abu Hariba, dont la façade a été restaurée, mais dont l’intérieur attend encore sa rénovation.
Les visiteurs retournent ensuite au point de départ, remontant vers le parc Al-Azhar, comme s’ils pénétraient dans un autre monde. Dans la lueur paisible du coucher du soleil, des dizaines de familles se rassemblent pour rompre leur jeûne, comme autrefois. Comme l’a observé le voyageur français de Villamont lors de sa visite en Égypte au XVIe siècle, elles s’asseyaient « à même le sol, dans leurs cours ouvertes ou devant leurs portes, invitant les passants à partager leur repas. »

Cet article a été réalisé dans le cadre de Media Connect et a été publié à l’origine sur Masrawy.
Dernières Histoires









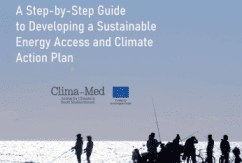
























 Syrie
Syrie